
À 61 ans, Spike Lee est plus que jamais animé par son activisme en faveur de la cause afro-américaine. Un sujet qui a traversé une grande partie de son œuvre, dont l’apogée fut atteinte avec Malcolm X, film-fleuve retraçant l’histoire du célèbre prêcheur américain. Une œuvre puissante, portée par un Denzel Washington au sommet, qui a fait de l’ombre au reste de sa propre production politisée. Ses prises de position parfois violentes, notamment face aux traitements de la question identitaire par d’autres réalisateurs, ne laissent aucun doute : Lee n’est pas un cinéaste du compromis.
Il n’est donc pas étonnant de le retrouver derrière BlacKkKlansman, un long-métrage basé sur des faits réels, qui narre l’histoire rocambolesque d’une infiltration réussie au cœur du suprémacisme blanc.

En plein cœur des années 70, alors que la lutte pour les droits civiques fait rage, Ron Stallworth devient le premier officier noir américain de la police de Colorado Springs. Une arrivée qui ne plait pas à tous ses collègues. Il va rapidement se pencher sur les agissements du Ku Klux Klan, et tenter d’infiltrer le groupuscule raciste pour en dénoncer les exactions. Il devra faire équipe avec Flip Zimmermann, qui deviendra sa doublure « blanche » (et juive) alors qu’il mène l’opération au téléphone. Ils vont comprendre qu’un attentat se prépare.
Ce pitch qu’on croirait rêvé par le réalisateur de Do the Right Thing lui permet de renouer avec un humour qui s’était peu à peu estompé de son travail militant. Il a d’ailleurs la bonne idée de réunir un casting homogène, sans qu’une grande figure (comique en particulier) n’écrase le reste. La nonchalance de John David Washington, fils de Denzel repéré dans la série Ballers sur HBO, se marie bien à l’aspect pince-sans-rire d’Adam Driver, décidément sur tous les fronts. Ils sont plutôt bien épaulés par Topher Grace, qui a bien saisi l’arrogance du personnage qu’il incarne (David Duke).

Le long-métrage oscille entre comédie et brulot, mais n’arrive pas toujours à trouver un vrai équilibre. La première partie du film, plus habile, décrit l’institution policière comme un problème et une solution à la crise qui traverse les États-Unis. La profession est en partie gangrenée par un racisme ordinaire, mais elle peut également devenir un tremplin égalitaire pour celui qui s’en approprie les codes.
Utilisé comme un agent infiltré, Ron se fond dans la masse des étudiants afro-américains et compatit avec ceux qu’il surveille. Lee insiste fortement sur cette double identité, et oppose sans cesse les visages des leaders noirs et blancs, les styles vestimentaires, les expressions verbales. De vrais notes d’humour surgissent de cette dualité. Il faut ainsi entendre David Duke se persuader qu’il détecte le « parler noir » tandis qu’il converse avec Ron.

Lee tisse également une réflexion sur la puissance évocatrice du cinéma, et son impact dans la vision des Afro-Américains par la société. À Naissance d’une nation (1915), immense succès en salle ayant provoqué la renaissance du Ku Klux Klan, il oppose son amour de la Blacksploitation. Un genre qui a volontairement joué avec les stéréotypes de la communauté avant de perdre de sa force vers la fin des années 70.
Les vieilles bobines montrant les morts de la guerre de Sécession, point crucial des frictions qui déchirent le pays encore aujourd’hui, laissent place à une esthétique funky dont Lee se délecte. Ce jeu humoristique autour du médium représente un des aspects les plus intéressants du film.

La seconde partie se veut plus convenue. La tension liée à l’infiltration est maintenue (bien que tous les membres du Klan soient présentés comme des débiles profonds), mais la tentative de romance entre le nouveau policier et une militante ne fonctionne pas. Comme effrayé que son message ne passe pas, Lee insiste fortement sur la résurgence actuelle du racisme aux États-Unis. En utilisant une partie du vocabulaire républicain des dernières décennies, il s’attaque directement à Donald Trump en mettant côte à côte les membres du Klan aux membres de l’ultradroite de Charlottesville, qui ont soutenu sa candidature.

Cette piqûre de rappel à grand renfort de stock-shots du JT insuffle un aspect documentaire et sauvage à l’ensemble, mais réduit sa portée cinématographique. Là où Jordan Peele, ici coproducteur, avait déployé un trésor d’ingéniosité dans Get Out et que Detroit (Kathryn Bigelow, 2017) résonne encore dans les têtes, la charge de Lee peut paraître plus manichéenne et globalisante. Elle reste malgré tout un vrai indicateur que le problème persiste au pays de l’Oncle Sam. Mais cette fois-ci, Lee a aussi voulu en rire.
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.







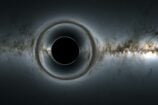
Discrimination positive.